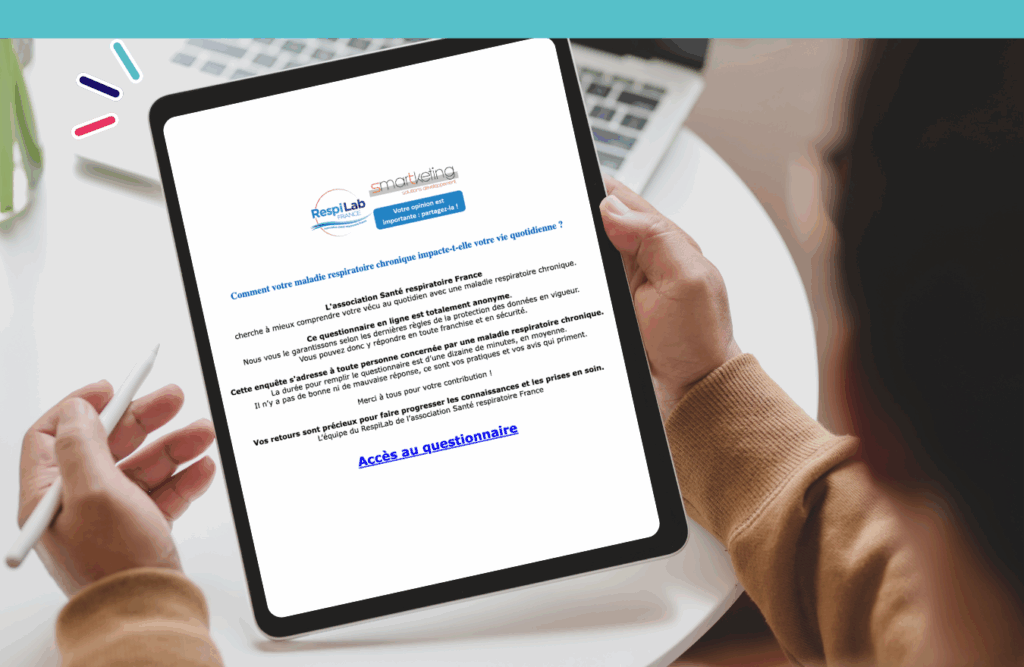Que font les personnes vivant avec une maladie chronique en prévention tertiaire pour mieux vivre avec leur maladie ? Il s’agit concrètement de toutes les mesures qui aident une personne déjà malade à éviter les complications, à ralentir l’aggravation de son état et à garder une meilleure qualité de vie. L’enquête annuelle conduite par le RespiLab de Santé respiratoire France montre que cela passe par un accompagnement complet, physique et psychologique, qui inclut aussi les aidants. Ce suivi fait partie du parcours de soins, avec de l’information, des conseils pratiques, et un accès simple et généralisé à la réadaptation respiratoire et à l’éducation thérapeutique (ETP).
Santé respiratoire France (SRF), association qui réunit patients atteints de maladies respiratoires chroniques, aidants et soignants, agit pour améliorer la prise en soin et la qualité de vie des 10 millions de personnes concernées en France par une maladie respiratoire chronique. Dans le cadre du fil rouge 2025, l’association a conduit, comme chaque année, une grande enquête diffusée largement au-delà de ses adhérents grâce aux réseaux sociaux et aux groupes de patients.
Prévention tertiaire, les enseignements de l’enquête SRF
Du 22 avril au 31 mai 2025, 841 patients ont répondu à un questionnaire en ligne de 41 questions, auto-administré via l’outil Modalisa, suivi de 14 entretiens semi-directifs de patients pour approfondir les points clés. Les participants présentaient des pathologies diverses : bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), asthme, emphysème, dilatation des bronches, apnées du sommeil, asthme sévère, cancer du poumon, allergies, fibrose pulmonaire interstitielle, etc. L’objectif de cette édition était d’évaluer l’impact de la maladie au quotidien et de décrire les pratiques de prévention tertiaire reconnues et/ou adoptées par les patients pour freiner la progression et les complications.
Pour commencer, il est important de noter que le terme même de “prévention tertiaire” n’est jamais employé par les patients : ils n’en connaissent ni la signification ni les contours. Leurs actions dans ce domaine relèvent donc d’une démarche empirique, fondée sur leur expérience personnelle plutôt que sur une compréhension structurée du concept.
Le poids des inégalités d’accès et d’accompagnement

Près de 6 patients sur 10 (59 %) ont vécu une exacerbation aiguë, c’est-à-dire un épisode d’aggravation de la maladie, au cours de l’année écoulée. Parmi eux, 22 % ont été hospitalisés à la suite de cet épisode. Ces hospitalisations représentent un coût majeur, non seulement humain mais aussi économique. « Renforcer la prévention tertiaire apparaît comme un levier essentiel pour réduire ces ruptures de parcours et agir sur les dépenses de santé », commente Cécile Grosset, psycho-sociologue qui a réalisé l’étude.
Par ailleurs, l’accès aux spécialistes demeure difficile : près d’un patient sur deux (48 %) estime que le délai pour obtenir un rendez-vous chez un pneumologue est trop long. Autre donnée de l’enquête, « seuls 12 % déclarent avoir bénéficié d’un programme d’éducation thérapeutique (ETP), un chiffre probablement sous-estimé car de nombreux patients ne font pas le lien entre le contenu du programme et son appellation, fait-elle remarquer. Enfin, ils ne sont que 14 % des répondants à avoir suivi une réadaptation respiratoire. L’offre actuelle reste insuffisante et ne semble pas correspondre aux besoins réels. »
Une prévention qui englobe santé, bien-être psychologique et qualité de vie
Les pratiques de prévention tertiaire les plus souvent citées spontanément étaient l’activité physique (70 %), l’adhésion aux traitements, c’est-à-dire être convaincu de l’intérêt de son traitement et le prendre correctement pour stabiliser la maladie (32 %), et l’amélioration de l’état psychologique (19 %). Car la prévention chez les personnes atteintes de maladie chronique, ici respiratoire, ne concerne pas uniquement la prévention de la dégradation de l’état de santé général (par exemple la vaccination contre la covid, la grippe ou le pneumocoque), ni seulement le maintien de la fonction respiratoire et musculaire par l’activité physique et la prise correcte du traitement, ou encore la prévention des événements d’aggravation de la maladie (exacerbations). Elle inclut aussi le bien-être psychologique et la qualité de vie.
Des pratiques adoptées mais encore sous-estimées comme outils de prévention tertiaire
L’enquête a quantifié ces pratiques de prévention, déclarées par les intéressés, qui apparaissent inégales et insuffisantes. A titre d’exemple, 77 % jugent leur traitement médicamenteux bénéfique et 83 % se déclarent observants dans la prise de médicaments. 88 % estiment leur dispositif médical utile (appareil de pression positive continue dans les apnées du sommeil, par exemple) et 86 % se disent observants. La perception d’un bénéfice pour la personne atteinte de maladie respiratoire encourage ainsi les bonnes pratiques.
- Concernant la vaccination, 78 % ont déclaré avoir reçu celle contre le Covid-19, 60 % contre la grippe et 49 % contre le pneumocoque.
- Seuls 24 % pratiquaient une activité physique quotidienne, 25 % déclaraient recourir à la méditation, au yoga ou à la cohérence cardiaque.
- 12 % avaient suivi un programme d’éducation thérapeutique du patient, et 32 % s’étaient vu proposer une réadaptation respiratoire.
- En parallèle, 62 % signalaient l’absence de proposition d’accompagnement au sevrage tabagique, alors que 14 % fumaient encore.
Cécile Grosset précise : « les gestes barrières, la vaccination et le sevrage tabagique sont assez bien adoptés, mais restent peu valorisés comme outils de prévention tertiaire dans l’esprit des patients. »
Entre freins, motivations et accompagnement : les ressorts de la prévention tertiaire
L’analyse qualitative des verbatims met en évidence des freins (condition physique, moral, méconnaissance de la pathologie, dégradation de l’état de santé) et des motivations (maintien d’une qualité de vie acceptable), qui rendent nécessaire un accompagnement (éducation thérapeutique du patient, réadaptation respiratoire, dynamique de groupe) pour favoriser l’adoption de pratiques de prévention tertiaire au quotidien.
La réadaptation respiratoire, le sentiment d’appartenance à une communauté et les mises en situation (activité physique, dégradation de la pathologie) apparaissent comme des éléments déclencheurs de comportements de santé favorables. En voici le détail.
Les facteurs de motivation à l’action
« La principale motivation à l’action reste axée sur le maintien d’une qualité de vie acceptable », annonceCécile Grosset.
L’envie de rester autonome pousse à maintenir une vie sociale et se sentir utile dans le sens de « apporter à l’autre un soutien, de l’aide, une information… ». L’énergie de vie se traduit par le désir de rester actif et de profiter du quotidien, renforcé par la conscience de l’évolution de la maladie. L’entourage et l’environnement, qu’il s’agisse de proches, d’animaux ou d’un cadre de vie favorable, soutiennent cette motivation. La curiosité, pour sa pathologie ou les avancées de la recherche, constitue un autre moteur d’action.
Malgré la diversité des parcours de vie, trois postures se distinguent en ce qui concerne les comportements adoptés par les malades respiratoires face à la prévention tertiaire, analyse Cécile Grosset. « Les « proactifs » (42 %) sont disciplinés et rigoureux, souvent plus âgés et diagnostiqués depuis longtemps. Ils semblent avoir accepté leur pathologie, connaissent bien ses mécanismes et adoptent des comportements favorables pour gérer leur quotidien, en mettant en place des routines. » Un témoignage illustre cette posture : « Mon souhait, c’est de vieillir en bonne santé, de manière à ne pas être un « boulet » pour mes enfants. ».
De leur côté, les « réactifs » (33 %) s’adaptent en permanence pour maintenir un équilibre de vie. Ils sont modérément sensibles aux éléments qui leur permettent d’améliorer leur condition respiratoire. Ils sont plus jeunes (moins de 55 ans), sont encore en activité professionnel et pris par la vie de famille. Enfin les « inactifs » (25 %) se déclarent peu concernés par la prévention tertiaire qu’ils laissent en sourdine, car ils sont en général moins impactés que les autres dans leur quotidien du fait d’une pathologie plus légère.
Les proactifs : discipline et routines
Ainsi, les personnes avec le profil « proactif » respectent une discipline installée par nécessité. Certains adoptent des routines, d’autres s’appuient sur des facteurs externes, comme la sortie du chien ou le soutien de pairs. Ils ont généralement traversé les phases de doute et sont convaincus des bienfaits de l’activité physique et de l’observance. Un exemple parmi les témoignages : « Je sais que si je ne fais pas ça (réadaptation respiratoire, kiné), cela ne va pas s’arranger. Je veux au moins me maintenir dans un état correct pour pouvoir vivre bien. »
Les réactifs : adaptation et appréhension
En revanche, les « réactifs » sont plus fragilisés, parfois en déni, et recherchent un cadre et du soutien. Plus jeunes, avec une vie sociale plus dense, la dégradation de leur état de santé leur fait peur. Ils connaissent moins bien les mécanismes de leur maladie et peuvent entretenir des croyances contreproductives.
« Tester c’est l’adopter », où la mise en situation devient un élément déclencheur
Parmi les éléments déclencheurs à la mise en place de gestes ou d’actions de prévention tertiaire sont cités :
- Le passage par un centre de réadaptation respiratoire, lequel favorise une meilleure connaissance de la pathologie et l’adoption de comportements favorables pour la santé.
- On trouve aussi l’appartenance à un groupe, que ce soit dans le cadre de la réadaptation respiratoire, d’une association ou d’un contexte familial sensibilisé.
- Les conseils des professionnels de santé, lorsqu’ils existent, s’avèrent efficaces dès lors qu’ils sont ciblés et personnalisés. Une patiente explique comment son médecin l’a guidée pour sortir progressivement de sa zone de confort.
- Mais c’est aussi la dégradation de l’état de santé, par exemple les bronchites à répétition ou les hospitalisations, qui peuvent inciter à adopter des comportements favorables. Les personnes atteintes de maladie respiratoire comprennent alors que certains gestes, comme l’activité physique et l’observance du traitement, deviennent vitaux.
Des freins à l’action pour être « auteur » de sa santé
Globalement « les freins à l’action incluent un état psychologique fragile, la méconnaissance de la pathologie, le manque de conseils ou de structures, les coûts élevés des dispositifs ou activités et une condition physique limitée », résume Cécile Grosset.
- Déjà, la condition physique limite l’action : fatigue, essoufflement, douleurs et mobilité réduite liée au vieillissement ou aux comorbidités.
- L’état psychologique freine également : perte d’espoir, stress, anxiété, déni ou procrastination. Certains regrettent de ne plus pouvoir pratiquer certaines activités, comme des randonnées, ou préfèrent éviter de penser à leur pathologie. La pudeur empêche aussi de parler des impacts sur le quotidien.
- Ce qui apparaît dans l’enquête de Santé respiratoire France est que la méconnaissance de la maladie entraîne des croyances et idées reçues, comme l’idée que l’asthme serait déclenché par l’anxiété ou que le traitement « répare d’un côté et abîme de l’autre ». Certains font des pauses ou s’immobilisent lorsqu’ils se sentent essoufflés.
- Le manque de ressources de proximité, l’absence de conseils pratiques des professionnels de santé et le coût des activités ou dispositifs freinent fortement l’action. Illustration avec ce verbatim d’une patiente : « Le médecin m’a dit qu’il fallait que je sorte de ma zone de confort. Quand on en parle c’est sympa, mais quand il faut passer à l’action c’est autre chose… Je suis dans l’appréhension, j’ai la crainte de déclencher la crise d’asthme ».
Ce qui encourage l’activité physique chez les malades respiratoires
Une pratique antérieure, comme la marche ou la réadaptation respiratoire, crée des habitudes. Les bénéfices sur le souffle et le moral renforcent la motivation. L’encadrement par un professionnel, la famille ou un groupe facilite l’adhésion, tandis que l’absence de compétition permet de rester concentré sur soi-même.
Les mots-clés qui ressortent dans l’enquête pour faciliter l’activité physique sont : pratique antérieure, bénéfices ressentis (physiques et psychologiques), encadrement et encouragement pour une pratique adaptée. « Avec l’activité physique, progressivement, on voit qu’on sait faire les choses de mieux en mieux avec un peu plus d’aisance », peut-on lire parmi les verbatims des répondants. Ou encore : « Le travail en groupe est une émulation qui est un moteur incroyable dans l’acceptation de beaucoup de chose comme le sport : il y a l’élément moteur du groupe et du coach ».
Zoom sur le respect du traitement et la bonne hygiène de vie
Un traitement simple à prendre, avec une dose unique quotidienne et un packaging facile à transporter, renforce l’adhésion. La perception des bénéfices au quotidien encourage la régularité : c’est souvent en interrompant le traitement que le malade prend conscience de son efficacité. Enfin, l’installation d’une routine, qu’il s’agisse de la prise du médicament, de l’activité physique ou du suivi médical, favorise une meilleure qualité de vie.
Sans suivi, l’observance s’essouffle
Quand les effets secondaires prennent le dessus… Plusieurs obstacles limitent l’observance. Certains patients doutent de l’efficacité du traitement, subissent la contrainte de protocoles complexes ou sont déstabilisés par un changement de médicament. Les traitements « en cas de besoin » posent aussi problème, car il n’est pas toujours facile d’identifier le bon moment pour les prendre. Par ailleurs, l’absence de bénéfices perçus entraîne parfois un décrochage, surtout chez les profils réactifs. Bien entendu, le manque de suivi médical, qu’il soit volontaire ou lié à des difficultés d’accès aux soignants, renforce ce phénomène. Enfin, les effets secondaires peuvent décourager l’adhésion, comme l’abandon du masque de pression positive continue (PPC, pour traiter le syndrome des apnées hypopnées du sommeil) par une personne souffrant également de spondylarthrite ankylosante.
Entre fatigue, isolement… et poids de la culpabilité
La souffrance morale est omniprésente dans le cadre des maladies chroniques respiratoires en général, marquée par le stress et l’anxiété liés à la peur de l’étouffement ou de la dégradation, qui renvoie directement à la peur de mourir. La fatigue en elle-même limite les activités et génère frustrations et isolement. Beaucoup de patients associent leur pathologie au vieillissement, renforçant ce sentiment d’exclusion. Autre point, retrouvé dans cette étude comme dans de nombreuses autres, le fait que la maladie, invisible pour l’entourage, nourrit l’incompréhension et pousse au silence. Quant aux discours publics sur les coûts de la maladie, ils accentuent encore la culpabilité, surtout chez les anciens fumeurs. « Sentiment récurrent repéré dans cette étude, les malades respiratoires expriment un sentiment d’impuissance et un certain fatalisme, ajoute Cécile Grosset. Pudiques sur leur souffrance, ils accueillent néanmoins positivement la possibilité d’en parler avec une tierce personne. »
Le recours à un professionnel de la santé psychique, rarement évoqué
Pour limiter l’impact psychologique, plusieurs leviers sont mobilisés par les personnes ayant répondu à l’enquête. L’activité physique régulière, souvent évoquée, parfois vécue comme un véritable médicament, apporte des bénéfices évidents : elle renforce l’estime de soi et s’accompagne souvent de pratiques comme le yoga, la méditation ou les exercices de respiration. Le soutien moral, qu’il vienne de la famille, des amis ou de rencontres avec d’autres malades dans des activités de groupe, joue aussi un rôle déterminant. Beaucoup privilégient une attitude positive, en cultivant l’optimisme et en recherchant le plaisir dans des activités simples, tout en donnant du sens à leur vie. En revanche, le recours à un psychologue ou un psychiatre reste rarement évoqué, certains s’interrogeant même sur l’intérêt d’une telle démarche.
Quand l’information et le lien font la différence
Finalement, les attentes des personnes vivant avec une maladie respiratoire chronique sont claires et partagées. Les interviewés expriment des besoins convergents. Ils souhaitent disposer d’informations fiables et pratiques sur leur pathologie et sur les bonnes pratiques à adopter, à l’image des newsletters et publications associatives déjà appréciées. La mise en réseau avec d’autres patients apparaît comme un désir fort, qu’il s’agisse de groupes de discussion, de forums ou de rencontres permettant de partager entre pairs. Une aide concrète pour s’orienter dans le parcours de soins, identifier les structures dédiées et les professionnels de santé est également attendue. Plus implicitement, les malades aspirent à une meilleure reconnaissance des maladies respiratoires et de leurs impacts au quotidien, ainsi qu’à un soutien psychologique indirect, à travers l’écoute et des espaces d’expression.
Cécile Grosset : « Les trois enjeux clés pour la prévention tertiaire sont : faire du « bien-être global » du malade respiratoire un objectif central revendiqué ; promouvoir la réadaptation respiratoire « sous toutes ses formes » en direction de tous les acteurs et la déployer pour favoriser la prise en soin au sens large ; faire connaître et faciliter les accès pour tous aux dispositifs qui favorisent le bien-être dans son ensemble ».
Prévention tertiaire : passer à l’action !
Pour renforcer la prévention tertiaire, plusieurs actions ciblent les patients, ce que Santé respiratoire France a résumé en un mot : la Prev’Action. « Il faut pour cela améliorer la compréhension du parcours de soins, analyse Cécile Grosset, de nombreux patients découvrant leur maladie sans connaître ses impacts ni les facteurs qui affectent leurs poumons. Expliquer le parcours dès le diagnostic permet d’adopter une dynamique d’action. De plus, le transfert de savoir-faire et de savoir-être personnalisé aide patients et aidants à mieux gérer la pathologie, favorisant l’adhésion au traitement et au suivi. » Autre volet complémentaire, celui de la prévention et la gestion des exacerbations doivent être renforcées : beaucoup de patients manquent d’informations pour les reconnaître, alors qu’une prévention tertiaire efficace réduit les hospitalisations évitables et leurs coûts. Enfin, un accompagnement durable, incluant le soutien motivationnel après le diagnostic, permet de maintenir les changements d’habitudes de vie sur le long terme.
Pour renforcer la prévention tertiaire, la formation des aidants et des professionnels de proximité est primordiale : présents quotidiennement aux côtés des malades, ils constituent des piliers et doivent maîtriser le bon usage des traitements. La promotion et le déploiement de la réadaptation respiratoire et de l’éducation thérapeutique sont également clés : ces dispositifs permettent aux patients d’acquérir des compétences d’auto-soins, de sécurité et psychosociales, améliorant leur qualité de vie avec une maladie chronique. Enfin, les aspects psychologiques doivent être intégrés : l’anxiété et la dépression sont fréquentes, et la réadaptation respiratoire doit inclure des outils de gestion du stress, tout en valorisant l’activité physique comme facteur de socialisation, de motivation et de réduction du stress.
Référence :
La prévention tertiaire pour les malades respiratoires chroniques ; Analyse qualitative de 14 entretiens semi-directifs de malades respiratoires chroniques (Juillet 2025)
Du 22/04 au 31/05/25, 841 patients ont répondu à une enquête en ligne (41 questions) auto-administrée (Modalisa), par Cécile Grosset (Agence Smartketing), co-construite et validée avec le comité scientifique de SRF au sein du RespiLab.