Sommaire
ToggleLa revue de presse de l’association Santé respiratoire France, l’actualité à picorer, au plus fort de l’été…
Arrêt du tabac : la varénicline fait son come-back après quatre ans d’absence

La varénicline, commercialisée sous le nom de Champix®, revient en pharmacie après quatre années d’interruption. Ce traitement s’adresse aux fumeurs adultes très dépendants à la nicotine, en seconde intention après les substituts nicotiniques.
- Le principe ? La molécule active, le tartrate de varénicline, se fixe sur les mêmes récepteurs nerveux que la nicotine, bloquant ainsi la sensation de plaisir liée à la consommation de tabac. Cette action diminue le besoin de nicotine et atténue les symptômes de sevrage, comme l’irritabilité et les troubles du sommeil.
- Prescrit sur ordonnance pour une durée de 12 semaines, le traitement peut être renouvelé une fois si nécessaire. La varénicline a une efficacité comparable à celle des substituts, confirmée par la Haute Autorité de santé (HAS) en mars 2025.
- Parmi les effets secondaires fréquents figurent nausées, insomnies et maux de tête. Les données disponibles n’ont pas révélé d’augmentation du risque d’effets indésirables graves neuropsychiatriques ou cardiovasculaires liés à la varénicline. Un sur-risque suicidaire, longtemps évoqué, est aujourd’hui entièrement réfuté.
- Par précaution, ce médicament ne convient pas aux femmes enceintes, aux moins de 18 ans, ni aux insuffisants rénaux sévères.
« Son retour, une bonne nouvelle, ajoute une option supplémentaire pour les patients en difficulté avec les autres traitements, en favorisant un arrêt du tabac durable », se réjouit le Pr Yves Martinet, président du Comité National Contre le Tabagisme (CNCT) et pneumologue au CHU de Nancy.
Le prix s’élève à 27,70 euros pour une boîte de 28 comprimés pelliculés dosés à 1 mg, et à 54,98 euros pour une boîte de 56 comprimés, avec un taux de remboursement fixé à 65 %.
Référence : Avis HAS Champix /Commission de la transparence le 12 mars 2025 ; Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques Texte n° 56 JORF n°0117 du 20 mai 2025
Adénocarcinome du poumon : la survie de ce cancer progresse, les profils des patients évoluent

L’étude KBP-2020-CPHG, coordonnée par le Collège des pneumologues des hôpitaux généraux, s’appuie sur des données recueillies en 2000, 2010 et 2020 dans les hôpitaux publics français (hors centres universitaires). Elle vient de paraître et met en évidence un net progrès dans la prise en charge de l’adénocarcinome pulmonaire (un type de cancer bronchopulmonaire), avec une survie à trois ans qui a plus que doublé en vingt ans : elle est passée de 16,3 % en 2000 à 38,6 % en 2020. Cette progression s’explique par des avancées combinées dans plusieurs domaines : l’imagerie médicale, qui permet une détection plus précoce ; la précision accrue du diagnostic grâce à l’immunomarquage et à une meilleure classification histologique (la nature de la tumeur) ; les techniques chirurgicales mini-invasives ou robotisées ; et le développement des stratégies péri-opératoires.
L’apport des analyses génétiques a également été déterminant. Le recours à des plateformes de biologie moléculaire a facilité l’identification rapide de mutations génétiques impliquées dans la survenue du cancer qui peuvent être ciblées par des médicaments précis, ouvrant l’accès à des thérapies personnalisées. Ces évolutions se traduisent concrètement par une meilleure survie des patients porteurs de mutations principales (EGFR, ALK ou ROS1) traités par thérapies ciblées : en 2020, leur survie à trois ans atteignait 36 %, contre 18,5 % pour les patients sans mutation. Chez ceux atteints de formes de cancer avec des métastases (lorsque des cellules cancéreuse disséminent ailleurs dans l’organisme), l’introduction de l’immunothérapie comme premier traitement améliore aussi la survie (36,2 % et 21 mois de survie médiane avec immunothérapie, contre 14,3 % et 4,2 mois sans).
Le profil des personnes touchées a lui aussi changé : la part des femmes a augmenté de manière significative (24,5 % en 2000, 40,4 % en 2020), tout comme celle des patients de plus de 80 ans (12,7 % contre 6,4 %). Les auteurs notent également une hausse du nombre de cas chez les non-fumeurs et les patients ayant un indice de masse corporelle élevé, ce qui modifie les caractéristiques classiques associées au cancer du poumon. En parallèle, l’adénocarcinome est devenu le sous-type de cancer du poumon majoritaire (56,1 % des cas en 2020, contre moins d’un tiers en 2000).
Enfin, l’impact du stade au moment du diagnostic reste déterminant : chez les patients diagnostiqués à un stade précoce, la survie à trois ans atteint 84 %, contre seulement 21,3 % au stade métastatique.
Ces résultats soulignent l’enjeu de généraliser l’accès aux innovations diagnostiques et thérapeutiques, et renforcent la nécessité de mettre en place un programme national de dépistage organisé du cancer du poumon dans notre pays. Lequel est en cours d’expérimentation. Les premiers participants (fumeurs ou anciens fumeurs âgés de 50 à 74 ans) vont commencer à être inclus dans l’étude pilote menée par l’Institut national du cancer. Cette phase préparatoire vise à définir les modalités les plus efficaces pour organiser le dépistage du cancer du poumon, en vue d’une généralisation progressive d’ici à 2030.
Référence : Debieuvre D, Falchero L, Molinier O, et al. Survival of Patients with Lung Adenocarcinoma Diagnosed in 2000, 2010, and 2020. NEJM Evid. 2025 Jul;4(7):EVIDoa2400443.
Covid long : asthmatiques et patients BPCO plus exposés

Une méta-analyse regroupant 51 études montre que les personnes souffrant d’asthme ou de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) présentent un risque accru de développer un Covid long après l’infection. A en croire ce travail qui regroupe toutes les publications scientifiques considérées de bonne valeur, ce risque augmente de 41 % chez les asthmatiques et de 32 % chez les patients atteints de BPCO.
Les chercheurs avancent que l’inflammation chronique des voies respiratoires, déjà présente dans ces maladies, pourrait aggraver la réponse immunitaire au SARS-CoV-2. Plusieurs mécanismes sont évoqués : déséquilibre des cellules T (globules blancs chargés de coordonner la réponse immunitaire), excès d’interleukine 6 (molécule produite lors des infections et impliqué dans l’inflammation), ou encore relargage accru de certaines cytokines chez les asthmatiques. Ces phénomènes pourraient favoriser l’apparition de symptômes persistants, notamment un syndrome de fatigue chronique.
Ainsi, en cas d’infection, un asthme ou une BPCO préexistants exposeraient à un risque plus élevé de formes prolongées post-Covid.
Référence : Terry P, Heidel RE, Wilson AQ, Dhand R. Risk of long covid in patients with pre-existing chronic respiratory diseases: a systematic review and meta- analysis. BMJ Open Respir Res. 2025 Jan 30;12(1):e002528. doi: 10.1136/bmjresp-2024-002528.
Coexistence asthme- diabète de type 2 : l’inflammation en point commun ?

L’asthme et le diabète de type 2, deux maladies fréquentes, coexistent souvent. Une large étude suédoise (5 299 245 individus), fondée sur des registres de population, confirme cette association et suggère qu’un risque familial partagé pourrait exister. Cette hypothèse repose sur l’observation d’un état inflammatoire chronique commun aux deux pathologies, ainsi que sur l’existence de facteurs génétiques connus, même si l’agrégation familiale de leur coexistence n’est pas formellement démontrée.
Les résultats montrent que les personnes atteintes de diabète de type 2 présentent un risque accru de 44 % de souffrir d’asthme, comparées aux non-diabétiques. Ce lien ce lien persiste même après avoir tenu compte des différences d’indice de masse corporelle, bien que ce facteur reste un élément confondant important.
Plusieurs mécanismes physiopathologiques sont évoqués. Chez les asthmatiques, l’utilisation de corticoïdes oraux (ce qui n’incite pas, bien entendu, à se passer de son traitement) et un excès d’interleukine 6 (molécule inflammatoire liée à l’insulino-résistance) pourraient favoriser l’apparition d’un diabète de type 2. À l’inverse, chez les diabétiques, l’hyperglycémie pourrait augmenter le stress oxydatif et l’inflammation autour des alvéoles pulmonaires, contribuant au développement de l’asthme. Tout est encore au stade de l’hypothèse.
« Nous avons constaté une association entre l’asthme et le diabète de type 2, écrivent les auteurs, maintenue après ajustement sur l’IMC (indice de masse corporelle), ce qui indique que l’IMC seul n’explique pas cette relation. Nous avons également constaté une coagrégation des deux affections chez les frères et sœurs, ce qui indique que cette association est en partie due à des facteurs de risque familiaux génétiques et environnementaux communs. » Ces données incitent à renforcer le dépistage croisé et à mieux explorer les antécédents familiaux dans les deux pathologies.
Référence : Mubanga M, Gong T, Smew AI, et al. Association between asthma and type 2 diabetes in a Swedish adult population: a register-based cross-sectional study. Thorax. 2025 May 20;80(6):385-391.
Syndrome des apnées du sommeil : quels effets de la pression positive continue sur la somnolence, la qualité de vie et la mortalité ? Données récentes.

La ventilation en pression positive continue nocturne (PPC) est le traitement de référence du syndrome des apnées obstructives du sommeil, largement recommandé car il réduit l’index apnée-hypopnée, diminue la somnolence diurne et améliore la qualité de vie. En revanche, ses effets sur la mortalité globale et cardiovasculaire en lien avec les apnées du sommeil restent discutés. Les études observationnelles trouvent une association statistique nette entre apnées du sommeil non traitées et une augmentation du risque de décès et d’événements cardiovasculaires. À l’inverse, les essais cliniques randomisés n’ont pas confirmé un effet significatif de la PPC sur la mortalité liée aux apnées du sommeil, que celle-ci soit globale ou cardiovasculaire.
Pour essayer d’y voir plus clair, une revue systématique incluant des études observationnelles* et des essais randomisés** d’au moins un an suggère un effet favorable de la PPC sur la mortalité. Elle conclut que la PPC réduit le risque relatif de mortalité toutes causes confondues de 37 % et de mortalité cardiovasculaire de 55 % chez les patients souffrant d’apnées du sommeil ***. Selon les auteurs, « nos résultats concordent avec un effet potentiellementbénéfique du traitement par PPC sur la mortalité toutes causes confondues et cardiovasculaire chez les patients atteints d’apnées obstructives du sommeil. Les patients doivent être informés de cet effet de leur traitement, ce qui pourrait favoriser une meilleure acceptation de l’initiation du traitement et une meilleure observance, augmentant ainsi la probabilité d’amélioration des résultats. »
Cependant, il faut noter que les résultats divergent selon le type d’étude : les essais cliniques randomisés ne montrent pas de bénéfice significatif, alors que la majorité des études non randomisées (observationnelles) rapportent un effet favorable. Cette différence s’explique sans doute par le fait que les essais randomisés manquent de participants et sont de trop courte durée pour montrer un effet clair sur la mortalité globale et celle d’origine cardiovasculaire.
Les auteurs de cette nouvelle publication pointent le fait que la durée de suivi était généralement plus longue dans les études non randomisées comparé aux essais cliniques randomisés, ce qui augmente la probabilité d’y observer des événements graves, comme les décès toutes causes confondues. Les différences significatives sur ces deux critères observées entre les groupes avec ou sans PPC dans les études non randomisées, mais non retrouvées dans les essais randomisés, pourraient donc s’expliquer par un manque de puissance statistique de ces derniers (192 décès contre 139 430), et non par une absence d’effet du traitement. D’ailleurs, les auteurs estiment qu’un essai randomisé devrait inclure 23 785 participants pour atteindre une puissance de 80 % et démontrer un effet significatif de la PPC sur la mortalité globale.
D’autres explications sont avancées par les auteurs : une mauvaise observance du traitement par pression positive pourrait aussi expliquer le manque de puissance statistique de certaines études. Par ailleurs, ajoutent-ils, le syndrome d’apnées obstructives du sommeil présente une grande variabilité de manifestations, de causes et de mécanismes de la maladie (variabilité phénotypique et endotypique) : seul un sous-groupe de patients présente un risque cardiovasculaire élevé. Certains essais randomisés ont aussi inclus des participants ayant un syndrome léger ou peu de somnolence diurne, profils peu susceptibles de tirer un bénéfice cardiovasculaire du traitement. D’autres essais incluaient à l’inverse des patients ayant déjà présenté un événement cardiovasculaire, à un stade peut-être trop avancé pour que la PPC ait un réel impact. Les études observationnelles portaient souvent sur des personnes sans antécédent cardiovasculaire, chez qui l’effet préventif de la PPC pourrait être plus marqué.
En conclusion, un effet bénéfique se fait jour, mais comme la PPC est déjà largement utilisée du fait de nombreux bénéfices largement démontrés, il est peu probable qu’un nouvel essai de grande qualité – et de très grande ampleur – puisse être réalisé. « La balance bénéfices-risques est très en faveur du traitement par PPC dans le syndrome des apnées du sommeil selon les recommandations en vigueur, résume le Dr Laurent Nguyen, pneumologue (Bordeaux) et secrétaire de Santé respiratoire France. C’est un argument supplémentaire pour encourager la meilleure prise en charge possible de ces patients. »
Référence : Benjafield AV, Pepin JL, Cistulli PA, et al. Positive airway pressure therapy and all-cause and cardiovascular mortality in people with obstructive sleep apnoea: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials and confounder-adjusted, non-randomised controlled studies. Lancet Respir Med. 2025 May;13(5):403-413.
* Un essai clinique randomisé est une étude médicale où les participants sont répartis par tirage au sort entre différents groupes pour comparer l’efficacité d’un traitement.
** Un essai clinique observationnel est une étude où les chercheurs observent les participants sans intervenir ni modifier leur traitement.
*** HR = 0,63 ; IC 95 % = 0,56-0,72 et HR = 0,45 ; IC 95 % = 0,29-0,72, respectivement.
Baromètre 2025 des droits des malades : mieux informés, mais pas sur tout

L’édition 2025 du baromètre publié par France Assos Santé montre un contraste net : les Français se sentent mieux informés sur la santé en général, mais la connaissance des droits des malades progresse peu, voire recule.
- Pour la première fois, plus de 70 % des répondants déclarent se sentir bien informés sur chacun des grands sujets abordés (accès au dossier médical, système de santé, coût des soins, traitements, etc.).
- L’usage des outils numériques progresse aussi : 72 % des Français s’y retrouvent, avec un pic à 79 % chez les 18-24 ans (soit +18 points depuis 2022).
En revanche, début 2025 (période de l’enquête BVA) la connaissance des droits des malades stagne. Les répondants obtiennent en moyenne 8,3 bonnes réponses sur 13, contre 8,9 en 2024.
- Plusieurs droits sont moins bien connus, notamment le droit à l’indemnisation en cas de problème grave, le soulagement de la douleur, le respect du secret médical ou encore la possibilité de refuser un traitement.
- Seulement 47 % savent qu’il est possible de s’opposer à l’utilisation de ses données de santé.
- Seuls 33 % connaissent l’existence de représentants des usagers dans les hôpitaux. Près d’un Français sur deux ignore qu’il peut rédiger des directives anticipées.
- Le droit à la sédation profonde et continue jusqu’au décès est inconnu pour 51 % des sondés.
Les pénuries de médicaments persistent (39 % des Français concernés, 53 % chez les patients en ALD), sans alternative proposée dans 35 % des cas.
BPCO : l’observance probablement insuffisante de l’oxygénothérapie à domicile
Chez les patients atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) récemment mis sous oxygénothérapie de longue durée, l’observance semble très inférieure aux recommandations. C’est ce que montrent les premiers résultats (résultats préliminaires sur une partie seulement des participants) d’une étude présentée au Congrès de pneumologie de langue française (CPLF 2025 ; poster du Dr François Jounieaux de l’hôpital La Louvière à Lille).
Cette étude multicentrique, menée auprès de 200 patients dont l’état est stable, a porté pour l’instant sur les 61 premiers inclus dans 27 centres. La prescription moyenne était de 17 heures par jour. Une télésurveillance a été déployée à l’aide de deux dispositifs connectés. Les durées d’utilisation réelles observées sont très éloignées des 15 heures/jour recommandées. La médiane d’utilisation globale était de 8,9 puis 7,7 heures. La source fixe était utilisée environ 8 heures par jour, contre seulement 6 minutes pour la source portable. Seuls 20 % des patients atteignaient le seuil des 15 heures/jour. Dans plus d’un quart des cas, aucun recours à l’oxygène n’était enregistré certains jours. L’étude doit se terminer cet été 2025.
Toutes les études menées chez des patients atteints de BPCO à un stade avancé montrent que plus l’oxygène est utilisé longtemps chaque jour, meilleurs sont les résultats sur la santé et la survie.
BPCO : l’ombre du faible poids de naissance

Le tabac est la cause la plus connue de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Pourtant, près de la moitié des cas seraient liés à d’autres facteurs : exposition à la pollution ou à des substances toxiques (poussières, fumées), antécédents respiratoires (asthme, tuberculose), ou encore développement pulmonaire anormal dès la vie fœtale.
Une étude britannique de grande ampleur, menée auprès de plus de 250 000 personnes issues de la cohorte UK Biobank, s’est penchée sur le lien entre le poids à la naissance et le risque ultérieur de développer une BPCO. Résultat : les adultes nés avec un poids inférieur à 2,86 kg avaient un risque plus élevé de souffrir de BPCO (augmentation de 21 % du risque). Certaines interactions aggravantes ont aussi été identifiées, notamment le tabagisme maternel ou l’exposition précoce à la fumée. Pour expliquer ce constat, les chercheurs avancent plusieurs hypothèses : un faible poids de naissance pourrait refléter un développement pulmonaire incomplet, une inflammation chronique dès la petite enfance ou encore des séquelles de prématurité.
Ces données soulignent l’intérêt de surveiller la fonction respiratoire chez les personnes nées avec un faible poids de naissance. Mais attention, d’autres études devront étayer ce lien, avant de conclure à une relation de cause à effet directe.
Références : Gibson AM, Reddington C, McBride L, et al. Lung function in adult survivors of very low birth weight, with and without bronchopulmonary dysplasia. Pediatr Pulmonol. 2015 Oct;50(10):987-94.
Interdiction de fumer dans les lieux publics ouverts depuis juillet 2025

Depuis le 1er juillet 2025, il est interdit de fumer dans plusieurs espaces publics ouverts : plages, parcs, abords des écoles ou terrains de sport. L’objectif : protéger les enfants de l’exposition au tabac et lutter contre la banalisation du geste. Les terrasses de cafés ne sont pas concernées par cette mesure.
Les contrevenants s’exposent à une amende de 135 euros, correspondant à une contravention de 4e classe. Des contrôles seront assurés par la police municipale et les agents de police judiciaire.
Cette mesure s’inscrit dans le plan national de lutte contre le tabagisme lancé en 2023. Pour l’instant, le vapotage reste autorisé dans ces zones, mais des restrictions sont à l’étude : réduction du taux de nicotine et du nombre d’arômes, à l’horizon mi-2026.
HTAP : un nouveau traitement prometteur pour les formes sévères

Un essai clinique de grande envergure (étude Zenith, essai clinique de phase III chez 172 patients) a été mené chez des patients atteints d’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP), une maladie rare et grave des poumons et du cœur. Tous étaient à un stade avancé de la maladie, malgré un traitement de fond à la dose maximale.
L’étude a comparé l’effet d’un nouveau médicament, le sotatercept (inhibiteur de la signalisation de l’activine, administré par injection sous-cutanée, validé par les autorités européennes du médicament en 2024), à celui d’un placebo. Les patients recevaient une injection sous-cutanée du médicament, en plus de leur traitement habituel.
Après une période de suivi d’environ 10 mois, les résultats sont encourageants : le sotatercept a permis de réduire de manière nette le risque de décès, de greffe pulmonaire et d’hospitalisation pour aggravation de l’HTAP. Concrètement, les patients traités ont présenté moins de la moitié de ces complications par rapport à ceux ayant reçu le placebo.
Ce traitement ouvre une perspective nouvelle et même un réel espoir pour les patients atteints de formes sévères d’HTAP, considérés comme incurables.
Références : Humbert M, McLaughlin VV, Badesch DB, et al; ZENITH Trial Investigators. Sotatercept in Patients with Pulmonary Arterial Hypertension at High Risk for Death. N Engl J Med. 2025 May 29;392(20):1987-2000.
Les maladies respiratoires chroniques en forte hausse : un enjeu de santé publique négligé
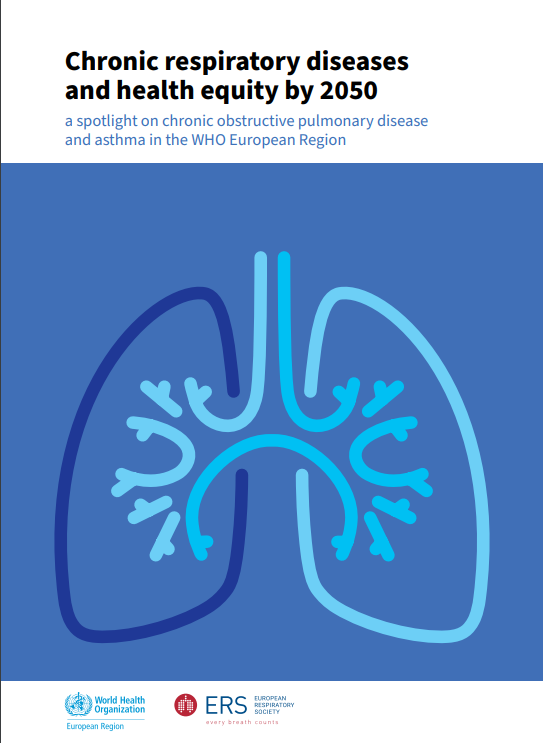
Plus de 80 millions de personnes vivent avec une maladie respiratoire chronique en Europe, selon un premier rapport conjoint de l’OMS et de la Société européenne de pneumologie (ERS). Ces maladies, comme l’asthme ou la BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive), causent de nombreuses hospitalisations, réduisent la qualité de vie et sont responsables de nombreux décès, souvent évitables.
Le rapport alerte : les maladies respiratoires chroniques sont mal détectées et mal prises en charge, faute de formation des soignants, d’outils de diagnostic (comme la spirométrie) et de financement. Résultat : des erreurs de diagnostic, des retards de prise en charge, et des décès parfois mal attribués à leur cause réelle.
La BPCO représente 80 % des décès liés aux maladies respiratoires chroniques. Sa progression inquiète : elle pourrait augmenter de 23 % d’ici 2050, surtout chez les femmes et dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Quant à l’asthme, les hospitalisations restent nombreuses, y compris chez les enfants, alors que des traitements efficaces existent.
Deux principaux facteurs de risque expliquent cette crise respiratoire : le tabac (encore fumé par un quart des adultes en Europe) et la pollution de l’air, à laquelle plus de 90 % de la population est exposée quotidiennement. Le rapport dénonce aussi la montée du vapotage et des produits de tabac chauffé chez les jeunes, qui représentent un risque à long terme.
Enfin, l’OMS regrette que le manque d’attention politique et le sous-financement aient fait reculer la recherche et la surveillance sur les maladies respiratoires chroniques. Elle appelle à une action urgente pour renforcer les systèmes de santé, mieux former les professionnels, prévenir les expositions toxiques et placer les maladies respiratoires chroniques au cœur des stratégies de lutte contre les maladies chroniques.
Le rapport : Chronic respiratory diseases in the WHO European Region

